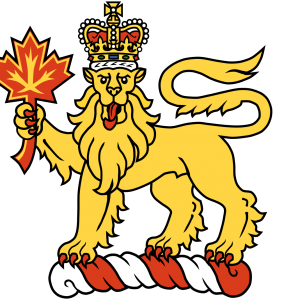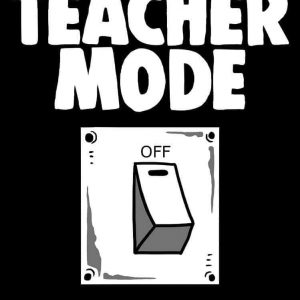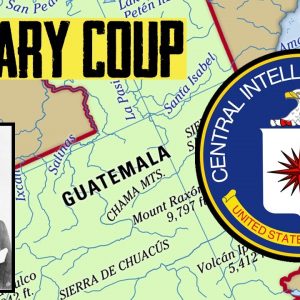Gouverneur général du Canada 101
Le rôle de gouverneur général est un poste clé de l’administration du territoire colonial français et britannique depuis les années 1600. Ne pouvant être présent physiquement dans chacune de ses colonies, le monarque nomme donc un gouverneur général pour le représenter. Nommé gouverneur de la Nouvelle-France en 1627, Samuel de Champlain a été le premier des 18 gouverneurs français qui ont dirigé la colonie jusqu’en 1760.